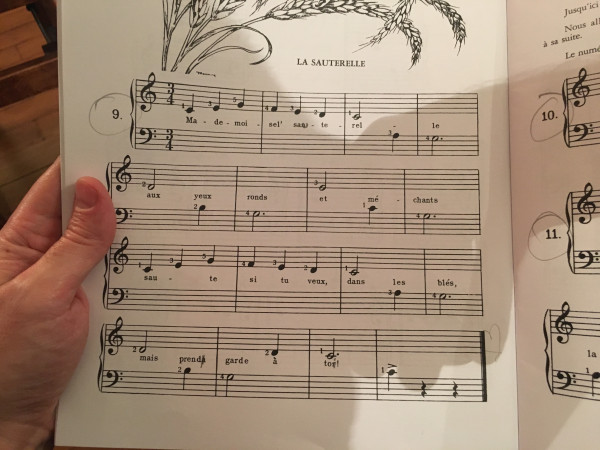Je suis l’auteur d’une pièce porno. Le co-auteur, en réalité, le texte m’en ayant été partiellement dicté alors que je rampais, en compagnie d’autres personnes, sous des tables, je ne sais pourquoi.
Dicté par une voix proche, par la voix proche de l’actrice.
Il s’agit d’un solo, interprété par ladite actrice, en interaction avec un spectateur à la fois.
Le texte est celui d’une petite annonce. Il y est essentiellement question de propositions indécentes faites au lecteur.
Il s’y propose des choses et il s’y expose une situation, s’y brosse un portrait.
Il est fait mention, aussi, d’une paire chaussures roses.
Mais il n’est pas très sûr que cette actrice soit vraiment une actrice.
Nous ne sommes pas seul. Je ne suis pas nous tout seul, moi-même.
Après, ça commence.
Le spectacle commence.
Et aussi, j’ai ma propre galerie. C’est une petite boutique, comme l’avant-pont détaché d’un grand magasin, d’une sorte de temple commercial. Je suis en devanture. L’espace est réduit mais la position paraît idéale. Et ma première exposition se réduit à un petit écran plat, sur lequel défilent mes œuvres. Des déclarations d’intentions plutôt. Ca commence par mille photocopies et par l’interview de quelqu’un d’autre, qui dit ce qu’est pour lui son travail. Et ce n’est pas moi. Ce n’est pas de moi. Mais il s’agit de moi tout de même, d’une certaine façon, en creux, par l’absurde.
Je parle soudain de cette galerie, de ce premier projet d’exposition, parce que c’est concomitant.
Ce type, qui parle – un architecte, il me semble – me rappelle plusieurs autres types qui sont à la fois amis et hostiles, attirants et antipathiques, alliés et ennemis. Il s’agit de ce genre de type dont on aurait envie de se dire « c’est un ami » mais dont l’aura bascule toujours en permanence vers une position d’incertitude qui l’éloigne. Dont le regard varie. Dont l’angle d’anxiété perturbe votre horizon. Dont la grimace contredit le sourire triste que promettaient les yeux.
Bref, ce genre de type dont soudain, avec effarement, je me demande si c’est moi.
Et, bien que je sache que ce n’est pas moi, il est cependant urgent que je me le demande.
Que je ne cesse de me le demander. Pour savoir où j’en suis. Pour savoir dans quel espace j’en suis.
Ce type parle sur cet écran ou parle en contrechamp de mon idée, dont je me demande soudain, avec effroi, si ce n’est pas la sienne. Si je ne suis pas le plagiat de cet être qui m’inspire ces sentiments ambigus et désagréables. Désagréables parce qu’ambigus. Ambigus parce que désagréables.
Bref, donc, ce genre de type est là, dans la queue. Parce qu’à présent il faut faire la queue.
Maintenant le texte a été prononcé. Le texte a été dit. L’actrice a promis des choses, proposé des choses, des choses sexuelles, une liste très précises de choses sexuelles qu’elle se propose de faire, de mettre en œuvre, là maintenant, et ce sont les spectateurs qui font alors la queue devant elle pour obtenir ces choses promises, choses dues.
Personnes n’est très pressé, personne n’est très à l’aise.
Et moins que personne moi-même.
Et aussi, je suis nu et tout le monde est là.
Tout le monde, c’est à dire surtout des gens que je n’ai pas vu depuis vingt ans et qui sont tous là soudain. Les amis du lycée, les amis de mes vingt ans. Les amis qui n’en sont plus tellement, ou de loin, de très loin. Des amis qui sont davantage des souvenirs d’amitiés que des amis au présent. Qui sont amis avec un souvenir de moi-même qui n’a plus grand-chose à voir avec moi, me dis-je.
Et je m’apprête aussi à faire la queue avec eux.
Et on me demande « alors, c’est toi qui a écrit ça ? ».
Et je bredouille.
Je n’en suis pas sûr.
Je suis découragé.
Je n’ai pas envie d’en voir plus. Je n’assume pas. J’ai envie de dire que je me suis trompé, qu’il ne faut pas faire des choses pareilles, que ça n’a pas de sens, que je me sens mal pour cette actrice. Mais alors je me souviens que c’est elle qui l’a voulu ainsi, que je n’y suis pas pour grand-chose.
Je doute même d’être partie prenante.
Je doute de ma véritable participation, de ma véritable implication et cela redouble le sentiment ambigu, à l’approche justement de ce type qui, lui, très à l’aise, fait la queue aussi. Et il porte chapeau, comme c’est curieux. Et un beau manteau de cuir. Il est élégant et sûr de lui. Il semble en position d’organiser les choses.
Il comprend tout, même mon désarroi, même ma lâcheté lorsque je vais me cacher dans ma boutique – qui est encore en travaux, c’est une tente me dis-je, je suis caché derrière un simple paravent, à peine séparé de la queue par un rideau fragile. Mais lui, le type sans nom, il m’accompagne avec bienveillance. Il vient me parler techniquement du déroulement des opérations. Feint d’ignorer mon évidente panique. Me fournit des alibis. Trouver un titre.
C’est ça, je me suis mis à l’écart pour trouver un titre, me dis-je, lui-même m’en fournissant le prétexte.
Un titre.
Je ne sais pas pourquoi j’ai pensé « deletathée » puis « deletathos » puis « deleteros ».
Et il y a tous ces amis, de l’autre côté, qui font la queue, qui attendent. Et je me dis que c’est sur la scène, avec l’actrice que je devrais me trouver.
Et tout à coup le titre m’apparait dans une clarté aveuglante: « J’ai peur ».
« J’ai peur », c’est un bon titre.
C’est un livre que j’écris.