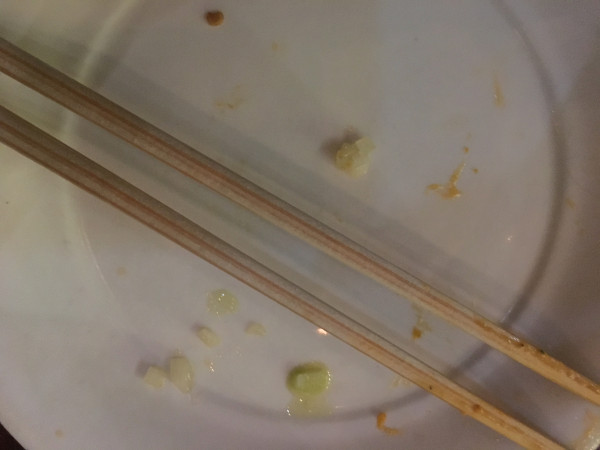Et là, maintenant, à cette heure, je ne sais plus du tout, absolument plus du tout pourquoi j’avais pris cette photo vendredi soir vers 1h04 dans ce bar de l’avenue Parmentier.
Sans doute quelque chose m’avait-il ému, touché, excité, intrigué, séduit, amusé, dans la pose, le regard et l’attitude de cette barmaid ? Sans doute, sans doute, puisqu’il y avait une autre photo d’elle.
Il faut avouer que j’avais trop bu, pensais-je.
Neuf verres, c’est trop, me dis-je.
C’est un de trop, me dis-je encore.
Huit, c’est ma limite, me dis-je, avec quelque expertise.
Passé neuf, je dois partir, m’excuser, respirer, rentrer lentement, faire face à un vertige, une nausée, regretter le dernier verre.
Mais neuf, c’est mieux que dix ou douze.
Là, je n’en parle même pas et je fais en sorte que cela n’arrive plus.
Déjà, neuf, c’est rare.
À neuf, on se demande quel était le verre de trop.
Le verre de Chardonnay pris en attendant G. au Grand 8 ?
Le verre de bière pris aux Cannibales ? Le petit shot de vodka qui l’accompagnait ?
Ou bien l’un quelconque des verres de Cairanne, de Beaujolais ou de je ne sais plus trop quoi ?
Et à quel moment les verres se dissociaient-ils de la série ?
Par exemple, les verres bus à midi avec G. ne comptent pas, n’est-ce pas ?
Mais le verre de vin pris en travaillant dans l’après-midi, juste avant de partir, dois-je
l’inclure ?
Alors cela ferait dix, me dis-je.
Mais de 19h à 1h, le temps file comme un élan, me dis-je.
Bref, me dis-je, je m’étais endormi sans même enlever mon pantalon.
Et réveillé à sept heures puis rendormi après avoir éteint la lumière, mais toujours avec mon pantalon. Ce besoin d’une protection. Contre le froid, la fatigue, les chats, la lumière du jour.
Puis neuf heures trente et les chats qui attendent leur biscuit.
Ce sont des chats qui ont droit à un biscuit au réveil. C’est comme ça. Et ils le savent.
Ils revendiquent. Dès cinq heures du matin, souvent, me dis-je.
Puis j’étais aller chercher C. et nous avions zoné toute la journée, parce qu’il faisait froid.
A peine une petite balade au bout de la rue chez Marian Goodman où une photo attire mon attention.
J’irai la photographier, si j’y pense, me dis-je.
Elle représente des gens en train de visiter un musée mais ils sont habillés comme pour une randonnée autour des lacs italiens. Les regards partent dans tous les sens. Vers l’intérieur des âmes, surtout. C’est un très grand format. On dirait un miroir, m’étais-je dit, tout à fait un miroir, avais-je pensé.
Bref, on avait zoné. La honte, me dis-je.
On s’était fait un shampoing anti-poux, parce que recrudescence à l’école.
J’avais fait des plans dans Autocad et C. avait regardé des dessins animés américains débiles dans lesquels des filles rêvent de super-marchés et tombent amoureuses toute les trente secondes du moindre crétin qui sort d’une salle de gym ou d’une cabine d’U.V.
Horreur, effroi.
J’avais préparé des travers de porc caramélisé et du riz japonais.
On s’était couchés avec des livres mais je m’étais endormi aussitôt.
Vers deux heures du matin, gamberge infinie.
Ne parvenant pas à dormir, j’avais attrapé mon télémètre laser et mesuré toutes les pièces de l’appartement.
Je m’étais recouché en me disant qu’il me faut au moins 48m2.
Je m’étais réveillé en me disant que j’allais probablement être assez profondément à découvert pendant les six prochains mois et je calculais mentalement le rythme mathématique de progression de ce découvert alors que C. me parlait de je ne sais quel dessin animé américain.
Ce matin, il fait beau et tiède. Je dépose C. à la danse et je vais au club de gym.
Ensuite, je dépose mes affaires, lance une lessive et file chez E., qui a fait du poulet.
On discute de nos névroses respectives et on organise des stratégies palliatives.
M. vient nous aider.
On refait le cosmos jusque vers 17h, puis les affaires reprennent.