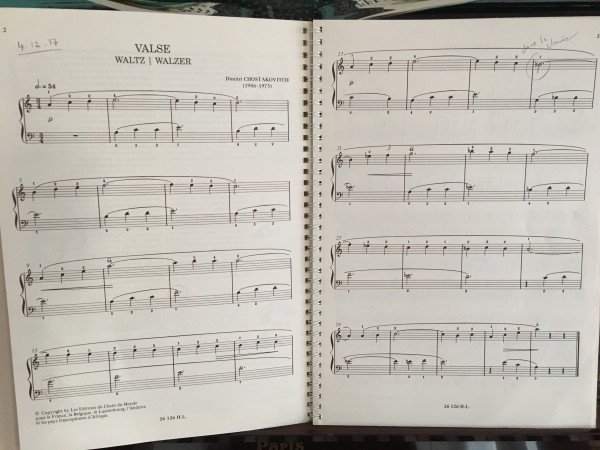
Je m’étais endormi d’un coup.
Pas même entendu la mise en veille des émissions de la nuit.
Et pas le moindre souvenir.
Trop de whisky japonais.
Trop de Chardonnay.
L’on s’était mis la tête en vrac, me disais-je.
Et hop, un doliprane® vers quatre heures du mat.
Ni vu ni connu.
Des nouvelles du Myanmar, avais-je remarqué.
Mais cela attendrait cinq ou six heures du matin.
Je retombais dans une somnolence.
J’avais décidé de n’y plus penser.
De ne rien prévoir.
Ou plutôt de prévoir rien.
Rien plutôt que cet obscur objet du désir.
Rien plutôt que la femme et le pantin.
De la musique et rien.
Des promenades et rien.
Rien, enfin.
Rien, soudain.
Et si quelque chose devait survenir, j’aurais au moins eu la satisfaction de ne m’attendre à rien.
Ne rien prévoir.
Ne rien attendre.
De bon, ni de mauvais.
Du brouillard sur la ville, ce matin.
Et une étrange douceur.
Et la lenteur du son dans l’air frais humide.
Et la vitesse du son.
L’attente du bus.
La retraite de l’empereur.
Les quatre cent cinquante mille hommes de la grande armée.
Berezina.
Dunkerque bientôt.
Le sommeil, le coussin. Je suis bien.
Je pense qu’il faut que je me déprenne de tout projet.
J’arrive à ce point de tranquillité.
Il fait doux.
Je glisse dans les rues roses.
Il y a les étudiants de première année.
On commence.
Je les saoule d’informations, mais comment faire autrement ?
On installe.
On lance.
Puis Y., le mémoire.
Déjeuner avec J-B. et S.
Japonais.
Bon enfant.
Joyeux.
Soleil.
Puis le mémoire, encore.
Puis P.
Visite à la radio.
Puis dehors, la ville, on dirait d’une guinguette.
On s’attend à un p’tit vin blanc.
Puis c’est une bière.
Une carbonade.
Et Y. encore et là, la trouvaille: 风景。
