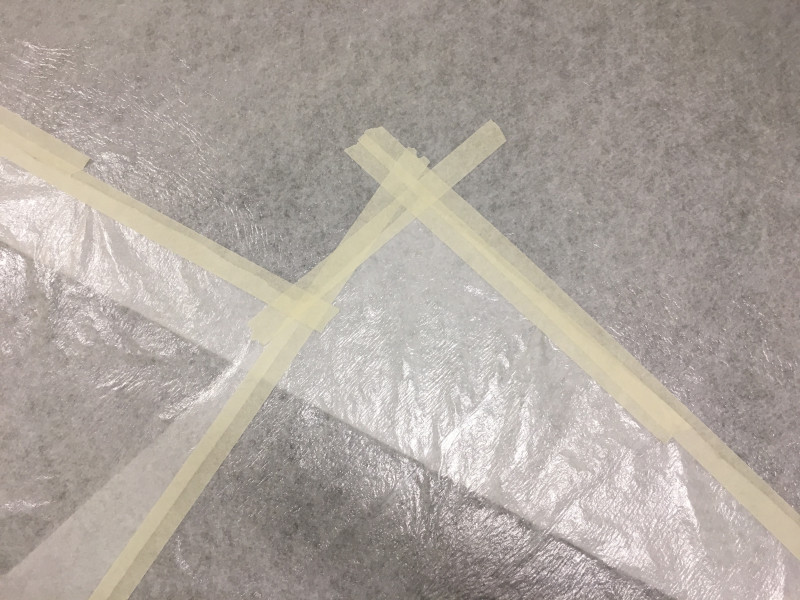Il s’était dit qu’à part le plaisir d’écrire, il n’y avait pas grand-chose à attendre de ce qu’il était convenu d’appeler « la vie ». La « vraie vie », comme on l’entendait dire (et cela faisait rire). La vraie vie, s’était-il dit, pouffant à s’en étouffer en mangeant sa tartine. Mais appeler ça un plaisir était tout de même un peu fort, s’était-il dit. Écrire était essentiellement une chose horrible. Moins horrible bien sûr que tout le reste, s’était-il dit. Et tout ce reste n’était rien. Et écrire n’était rien. Mais c’était ce peu de chose qui restait, s’était-il dit, ce peu de chose qui demeurait quand il ne restait plus rien. Et il ne restait plus rien. Mais aussi, avait-il ajouté, in petto, on pouvait aussi bien dire qu’il n’y avait jamais rien eu. Jamais rien eu d’autre que la folle espérance. Le fol espoir de la jeunesse. Il y avait eu la jeunesse, s’était-il dit et la jeunesse était une chose horrible, avait-il ajouté. Mais la vieillesse n’était-elle pas plus horrible encore ? — s’était-il demandé. Cela restait à prouver, s’était-il dit.
Et ce ruminant, il avait attaché son vélo et posé son sac. Il avait un moment caressé l’idée de s’asseoir là, sous la canopée et de commander un café mais ses poches étant vides il était allé s’asseoir dans le hall du conservatoire.
Le sac était lourd d’un kilo et demi de travers de porc, d’un paquet de choux de shanghai, d’un kilo de riz japonais, d’un sac de pâtes de riz coréennes, d’un sachet de porc séché mariné, d’une boîte d’oignons frits, d’une botte de coriandre et de divers menus accessoires. Le sac était lourd de lui-même. De sa propre toile. De sa propre structure. De sa pesanteur de sac. Le sac promettait un retour éprouvant, à deux sur le vélo sur les faux plats de Sébastopol, les faux plats qui mènent à Jaurès, les faux plats de la rue Armand Carrel, de la rue de Meaux, de la rue Petit et de l’entrée du Pré Saint-Gervais. À quoi il fallait ajouter le poids de l’antivol.
Heureusement, soufflait une petite brise. Mais il avait perdu l’idée qui avait provoqué cette première phrase. Une idée née de l’analyse, s’était-il souvenu. De la capacité d’analyse que permettait le langage, s’était-il dit. Du pouvoir de grossissement du langage et de l’écriture. De cette possibilité de s’étendre, de dilater le temps, d’étirer une idée, une impression. Il s’était dit qu’il y avait le temps de l’Histoire et le temps de la Vérité.
Aux yeux de l’Histoire, celui qui avait raison dans l’Absolu mais ne parvenait pas à rassembler un consensus valait moins, beaucoup moins, que celui qui avait tort dans l’Absolu mais parvenait à rassembler. Avoir raison dans l’Absolu n’avait aucun poids aux yeux de l’Histoire, s’était-il dit. Il y avait un autre lieu pour cela, s’était-il dit, avait-il espéré.
Cela commençait à sentir vraiment bon, les travers de porc caramélisés qui mijotaient depuis une petite heure et le riz bien chaud qui sifflait dans le rice-cooker. En allant faire les courses, il était tombé sur H.V., qui se rendait chez A.N., qui justement venait d’aménager juste à côté, en face, à cent mètres à peine. H.V. lui parla de son film mais il n’était pas libre pour la prochaine projection. Il faudrait remettre.
Et il se dit que c’était un peu con de parler de lui à la troisième personne et qu’il ne persévèrerait sans doute pas dans cette voie, bien qu’il soit peut-être intéressant d’essayer encore, de poursuivre encore. Cela mettait à distance, c’est évident.
Il avait envie de boire encore un verre de vin rouge mais il n’y avait que de la bière.
On attendait R. pour le tarot, les masques et le festin. Ce serait une belle soirée.